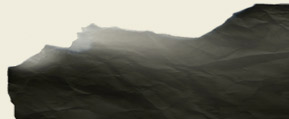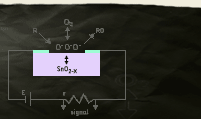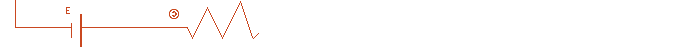Nous assistons à la présentation d’Une histoire de la performance en 20 minutes par Guillaume Desanges et Frédéric Cherboeuf, qui a lieu dans la salle de conférence du Magasin d’en face à Grenoble. Guillaume Desanges est coordinateur des projets artistiques aux Laboratoires d’Aubervilliers, lieu de création et de diffusion des arts plastiques et des arts du spectacle, en banlieue parisienne. Il est également critique d’art, commissaire d’exposition (notamment pour l’exposition Pick-up, présentée à la galerie Public à Paris) et membre du comité de rédaction de la revue Trouble. Formé au conservatoire de Rouen puis à l’École Supérieure d'Art Dramatique du T.N.S., Frédéric Cherboeuf est acteur, particulièrement au théâtre. C’est à travers le projet initié par Guillaume Desanges qu’il a découvert le travail des artistes de la performance. Une histoire de la performance en 20 minutes est annoncée comme une conférence dont l’enjeu propose d’envisager la performance hors de son contexte historique et comme une histoire du geste.
Le prologue à peine énoncé, la salle se trouve plongée dans une pénombre où ne subsiste que la lumière orientée d’un projecteur braqué sur les protagonistes. Les deux conférenciers sont tout d’abord installés derrière une table ; Guillaume Desanges commence alors la lecture de son texte, pour laquelle il adopte un ton laconique et un rythme tantôt haché, tantôt accéléré, oscillant entre objectivité distanciée et interprétation théâtrale. Puis, Frédéric Cherboeuf se lève et commence à s’exécuter : tout au long de la représentation, il alterne les poses fixe et les déplacements qui illustrent, au fur et à mesure, les performances dont il est fait mention. Ses gestes reprennent exactement ceux qu’un appareil d’enregistrement (photographique ou filmique) a saisis lors de ces performances et ainsi, il se substitue à la traditionnelle projection d’images. Le scénario proposé par les conférenciers, publié dans le numéro 5 de la revue Trouble et illustré de photographies prises lors d’une représentation d’Une histoire de la performance en 20 mn, est articulé en huit chapitres : apparaître, recevoir, retenir, fuir, viser, chuter, crier, mordre, se vider et disparaître. Ces huit verbes sont associés aux performances d’une vingtaine d’artistes dont les enjeux divergent considérablement. Cette sélection opérée par Guillaume Desanges semble étrangement provenir d’un manuel d’histoire de la performance : les artistes présentement cités appartiennent en effet au corpus d’artistes exclusivement étudiés et canonisés par les historiens, en particulier francophones. Ils sont également presque tous américains, ou originaires d’Europe du nord, ce qui correspond aux frontières géographiques à l’intérieur desquelles l’étude de la performance a été limitée. Paradoxalement, le protocole institué par Guillaume Desanges et qui repose sur une volonté d’écarter toute interprétation historique, dénote une approche tout à fait convenue et largement historicisée. Néanmoins, Une histoire de la performance en 20 mn soulève la problématique liée à la transmission et à l’inscription historique du phénomène artistique que représente la performance. La dimension théâtrale du projet de Guillaume Desanges témoigne tant d’une difficulté à rendre compte que d’une mécompréhension d’une histoire qui continue de résister.
Or, c’est dans cette résistance même à l’interprétation et dans l’écart historique qu’elle suppose, que l’intention de l’art de la performance peut continuer à exister. Dans son œuvre intitulée An Inadequate History Of Conceptual Art, Sylvia Kolbowski a mis en évidence cette inadéquation propre à la performance, et à l’art conceptuel en général. Pour ce projet, elle a demandé à une soixantaine d’artistes (à ce jour, une vingtaine ont été filmés) de « décrire une œuvre conceptuelle réalisée entre 1965 et 1975, à laquelle ils ont personnellement assisté et dont ils ne sont pas l’auteur ». Ce qu’elle nomme ici « œuvre conceptuelle » comprend toute action documentée par des dessins, des photographies, des films ou des vidéos, tout concept réalisé sous la forme de dessins ou de photographies, tout objet produit dans le but d’enregistrer une installation temporaire ou encore, toute activité performative qui bouleverse les conventions du théâtre et de la danse. L’artiste a également spécifié à chaque artiste de ne mentionner ni l’œuvre qu’ils décrivent, ni le nom de son auteur, ni leur propre nom. Chaque entretien a été enregistré, mais seules les mains des artistes ont été filmées. Lorsque cette œuvre a été exposée à l’American Fine Arts à New York en 1999, les bandes sonores étaient dissociées de l’image vidéo, et présentées dans deux espaces séparés.
Sous différents aspects, l’œuvre de Sylvia Kolbowski s’avère tout à fait pertinente : d’une part, la dimension anonyme et anecdotique qu’elle met en exergue s’oppose aux formes d’une interprétation mystificatrice ou spectaculaire. Les témoignages recueillis constituent une mémoire disjointe et individuelle, altérée par le temps et l’expérience accumulée. À travers leurs récits, qui portent principalement sur la performance, les artistes énoncent les difficultés à rendre compte d’un événement auquel ils ont pu assister mais n’en saisir qu’un fragment. D’autre part, Sylvia Kolbowski, par le choix de son cadrage, accorde très justement une importance visuelle aux mains, non sans évoquer l’engagement pris par les artistes de la performance et de l’art conceptuel d’évacuer le savoir-faire et le culte de l’objet d’art, alors considéré comme unique médiation de l’expérience esthétique et comme pure présence optique. La performance, où l’objet est annexé au corps de l’artiste qui s’ex-pose et se met en mouvement, s’inscrit ainsi dans une dimension du geste.
Sur ce point, nous rejoignons la proposition de Guillaume Desanges – c’est-à-dire considérer l’histoire de la performance comme une histoire du geste. Il me semble cependant que cette notion mériterait d’être clarifiée et non, comme c’est le cas ici, classifiée et réduite en et à quelques actes - chuter, mordre, crier…
Tout d’abord, il nous faut distinguer, à la suite de Giorgio Agamben, le geste du faire et de l’agir. Dans ses « Notes sur le geste » (1), Agamben souligne en effet que ces derniers sont tous deux impliqués dans une économie productive : l’un, parce qu’il tend vers une réalisation où l’acte n’est que le moyen déployé pour y parvenir ; l’autre, parce qu’il revendique l’acte même comme production a priori, symbolique et morale. Le geste constituerait au contraire un acte inconditionné et inaliénable qui ne renvoie qu’à lui-même, c’est-à-dire à sa propre mise en mouvement. Agamben le considère comme une pure « médialité » : Le geste n’est pas un simple véhicule de la communication mais il l’excède et en ce sens, il ouvre la possibilité qu’une communication puisse avoir lieu.
Dans son essai, Agamben évoque également le phénomène d'« une société qui a perdu ses gestes ». Devenu, dès le dix-neuvième siècle, le vecteur d’une économie productive et définie en termes de rentabilité, le corps a perdu sa singularité, son savoir-faire, et par là même, son authenticité : il se trouve ainsi réifié comme instrument du travail et comme marchandise. Évoquant entre autres la danse d’Isadora Duncan, le roman Proustien ou le cinéma muet, Agamben reconnaît dans l’art de la modernité l’ultime tentative de récupérer le geste d’ores et déjà perdu à jamais. Or, c’est cette même perte que semblent consigner et acter les artistes de la performance : la violence contenue dans nombre de performances témoigne en effet de l’impossible retour du geste. L’espoir enraciné dans la modernité du début du siècle laisse place, dans les années soixante, au désenchantement : La performance ne serait donc pas à proprement parlé une histoire du geste mais le temps et le lieu de son deuil.
Dans Une histoire de la performance en 20 minutes, les actes accomplis par l’acteur depuis un espace théâtral, c’est-à-dire avant tout un espace illusionniste, ruinent toute reconnaissance socio-historique contenue dans le geste performatif. Le corps est ramené et contraint à une forme de spectacularisation. Le terme de « performance » est ici pris au pied de la lettre, c’est-à-dire comme une compétition : 20 minutes, cela signifie déjà défier le temps. Or, l’expérience de la durée est précisément ce qui est en jeu dans l’art et dans les gestes de la performance. L’attente, l’incertitude, l’étirement et la fulgurance, la répétition sont autant de composantes temporelles qui contrarient et constituent l’expérience esthétique. Les artistes interviewés par Sylvia Kolbowski parlent tous d’un climat de grande confusion et de tension : le public d’une performance, dans l’expectative d’un événement qui doit se produire, ne sait ni comment interpréter ce qui se déroule devant ses yeux, ni comment réagir. Dans Une histoire de la performance en 20 minutes, au contraire, le temps du récit propre à la forme théâtrale, avec un début et une fin définis, brise cette tension dans laquelle est maintenu le public. Les gestes des performances évoquées sont également coupés de leur dimension temporelle, statufiés et échantillonnés. Ainsi, ils perdent leur étrangeté et deviennent en quelque sorte burlesques.
L. G.
(1) Giorgio Agamben, "Notes sur le geste, in Moyens sans fins, Payot & Rivages, 1995