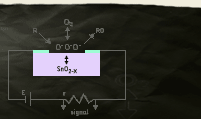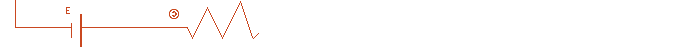| |
Entr'espace (de la ville)
Entracte (de chacun et de chacune)
Entre-tiens (le discours de soi)
Entr'éprise de lui et de l'autre
Entremise des uns ou des autres
Entrelacs de l'eau douce
Fils d'eau court le long de la berge
Mince filetage des méandres du sol
Déambulation quotidienne - j'entends la musique de la ville. Je prends la mesure d'un lieu nouveau pour moi, structuré par d'autres.
Sonores et visuels, les espaces de la ville agencés suivant une fonctionnalité précise me permettent de comprendre le montage occidental de l'urbanisme. Qu'il s'agisse de l'architecture, d'un mobilier urbain, des amas sonores aux décibels variés, la notion de plein et de vide s'offre à moi comme un haïku, une estampe, un lavis. Entre écriture et dessin, le silence fait œuvre. Ou, pour sortir de cette dichotomie positif/négatif, blanc/noir, ombre/lumière, ouvert/fermé, il y aurait une troisième solution, un troisième genre proposé par Doïna Petrescu, la khôra, un espace du devenir du monde, un espace qui ne s'oppose pas au temps mais qui en propose un autre, sonore, musical, celui de la parole. "(…) ce troisième genre, c'est ce qui est entre les opposés" et non la somme ou le compromis entre les opposés.
Dans ma circulation spatio-temporelle, j'emprunte des voies balisées, goudronnées de manière plus ou moins plane ou pavées suivant une régularité horizontale relative. Je suis un parcours qui pourrait me servir pour me rendre d'un point à un autre. Si j'adopte des chemins de traverse ou méandreux, j'opte pour un trajet aléatoire plus long ou plus court. Le paysage urbain s'y révèle musicalement autant que visuellement. Le passage du plan goudronné à celui caillouteux et sinueux révèle des endroits qui perdent la circonscription du sol public. Passer d'un sol à l'autre en ne sachant plus dans quel espace je circule faute, parfois, de clôture des jardins privés, correspond à une modification de l'espace sonore. Différents niveaux de vibration s'appréhendent.
Les chemins, les passages ou les impasses, ainsi nommés pour le repérage postal décrivent la configuration de ce fragment d'espace urbain. Fragile distinction entre ville et campagne pour les petites communes comme Fontaine.
Être à l'écoute de la cité permet de sentir le climat politique de la ville car une ville qui se préoccupe de sa propre musique devient une polis qui permet aux individus de se gérer sans se fondre dans une organisation préétablie.
Fontaine, petite ville de xxxxx habitants, située à la périphérie de celle, conséquente, de Grenoble, en bordure du Drac, propose aux résidants un état des décibels de la ville dans plusieurs zones. En vue d'accompagner la politique de ménagement auditif des citoyens, cette commune envisage sa musicalité dans son aspect le plus large : une fabrique de chocolat est détruite pour laisser la place à une école de musique. Elle sera inaugurée en 2008.
De la saveur du chocolat noir à la cannelle, orange avec des éclats de noix de cajou aux acoustiques polyphoniques, le savoir-faire se meut en savoir-travailler (ou éprouver par le désir).
Même si tous les résidants de cette ville n'entendent pas la même musique, au risque de s'abandonner à quelques violences engendrés par la concupiscence, ici la notion de nuisance sonore s'appréhende en corrélation avec la musique, son apprentissage et son emploi.
Loin des sirènes hystériques qui signifient l'arrivée de l'ordre, rompant avec les assonances et dissonances de la métropole, le tintement des cloches ponctue le glissement métallique du tube qui traverse cette ville, Fontaine. L'eau de la fontaine invisible, ou que je n'ai pas encore découverte, circule dans les canalisations souterraines autant que dans les creusets aménagés. Entre les rails et les rigoles des nouvelles dalles rosâtres de pigmentations diverses se dispersent dans une imbrication formelle aléatoire.
Entre le climat de la ville et sa température au pied des montagnes, l'enclavement géographique engendre des déplacements spécifiques.
Caprice du ciel et des étoiles qui, en solstice d'hiver, ouvre des variations de froidures par vagues irrégulières. Regard accroché au sol. Givre agrippé au creux des plis d'un goudron travaillé par le temps ou les superpositions de quelques strates de rebouchage après intervention municipale. J'avance et j'entends.
C'est ma façon de vivre la cité. Je m'arrête et je lis l'écrit, le texte de la ville. Entre slogans, phrases, initiales, graphs, signatures, je m'engage dans une voie nommée au bord des immeubles ou des maisons. Les plaques des rues, avenues, chemins, passages, cours, impasses qui renseignent sur la largeur et la longueur des voies m'indiquent une histoire des hommes que je peux retrouver ailleurs.
[le petit trait d'union entre le prénom et le nom qui signifie l'hommage à l'être historicisé permet de retrouver un chemin déjà parcouru].
Gabriel Péri, Jean Moulin, Yves Farge et tant d'autres qui ont résisté à l'ordre de l'autre jusqu'à leur dernier souffle. L'Allemagne et l'Italie sont aujourd'hui en partenariat avec Fontaine. Les langues et le langage se maîtrisent donc ici comme ailleurs. L'arrivée de communautés italiennes, espagnoles et d'Afrique du nord entre 1950 et 1970 participe à l'identité de cette ville. Mais comment ces langues et langages circulent-ils?
Quelles galeries de combustibles se sont-elles excavées pour la circulation des langues parlées, lues et écrites?
De la ville de l'escoutaire (celui qui écoute en occitan) en Languedoc-Roussillon à Fontaine, j'entends les musiques des langues. Les langages résonnent. Les intervalles s'ouvrent, la parole circule.
Être créateur d'espace, c'est osciller sans cesse entre dire et écrire, envisager une position inconfortable de l'entre deux espaces. De la page d'écriture qui contexture à la parole qui délie, file comme le flux de la crue du fleuve, la pratique de la ville s'envisage comme un acte à chaque pas. "(…)la pratique urbaine comme pratique curatoriale, comme travail de prendre soin, en latin curare ça veut dire ça : "curater", "soigner", "c'est un travail de "nourrice"! comme Khôra!" (Doïna Petrescu, in entretien avec Sylvie Desroches, Pratiques féminines de l'espace, p.49 de Radiotemporaire, ed. Magasin).
À l'opposé d'un livre qui me propose une maîtrise de la langue, j'écoute la ville et j'entends l'autre. Je prends conscience de l'importance de la circulation de la parole. Le fluide mouvant qui s'évapore dans l'air sitôt prononcé mais qui imprègne l'être persiste. Comme je ne suis pas constituée que d'écrit je reste en éveil quand on me parle, quand ça me parle. Ce qui me parle précisément, c'est ce qui échappe au contrôle et provoque de la jouissance. Sortir du sens des mots, de l'ordre du discours m'apparaît comme une solution d'existence artistique pour agir.
Sortir de la rationalité du sens et entrer dans l'espace sonore. Avant qu'elle ne s'écrive, la langue se parle.
La traversée du corps dans l'écriture de la ville s'accompagne de la captation de tout ce qui se dit. Aux espaces interstitiels géographiques que sont les squares (de manière organisée) ou les terrains vagues (béances temporaires) correspondent les espaces interstitiels sonores (espaces potentiellement créatifs temporels).
Passage de l'écrit–écrit à l'écrit-oral vers une oralité qui ne se retranscrit pas. La matérialisation de la parole serait la présence des corps pour entendre "la petite musique sous la langue". Entrer dans l'oralité sans sombrer dans la folie durasienne des parleuses qui emporte plus qu'elle n'amuse.
Faire vaciller la langue hors du sens, c'est perdre le contrôle et le pouvoir de la manipulation. Utiliser la langue pour la faire chanter, chanter soi-même, jouir du non-sens comme l'enfant qui ne maîtrise pas cette langue. S'extraire de la capture de la langue qui s'écrit en vue d'une forme dé liante orale et sonore.
Finnegan's wake par John Cage.
Les haïku japonais qui s'écrivent parce qu'ils sont sonores pour faire filer l'émotion de l'instant d'un fragment de la nature.
La circulation par l'oralité. Le maintient de l'histoire des individus. Si le journal de la ville s'appelle Mémoires en vue de dire de qui est constituée l'histoire de la ville, il évoque quelques faits signifiant les individus, il retrace le réseau des histoires, un peu à la manière de celui de l'escoutaire. Écouter les dires pour écrire sans biffure, c'est résister à la perte par superposition des couches de goudron. Pour ne pas déterrer les morts, il faut maintenir en existence pour soi, individuellement leur histoire.
Résister, glisser, participer à la vie, c'est travailler la ville de l'intérieur vers l'extérieur dans un mouvement perpétuel de va-et-vient. Explorer la ville par des chemins de traverses permet d'éviter les fantômes le long des grands axes pour usagers pressés de survivre.
La cartographie de la ville se dessine en zones de résonance. Les images émergent dans le temps de mes promenades.
"Le temps est l'étoffe qu'il faut travailler, coudre et découdre; il faut aller profond dedans, avec les mains, l'aérer, la renverser et l'ouvrir; y percer de nouveau raccourcis, y tracer de nouvelles ambulations, de nouveaux passages non vus…"(Valère Novarina, in Lumière au corps, P.O.L., p.9). Une langue qui circule, restitue l'espace urbain aux "viveurs". Déplacer le centre de la ville et proposer un redécoupage des quartiers. Le fluide sonore crée ce lien invisible qui s'éprouve par tous. L'image de la ville modifiée avant la clôture des travaux de l'école de musique.
Au théâtre, la langue orale se projette. Elle le fait de manière scripturaire, dans une visée de séduction. S'extirper de la fascination de ce qui se maîtrise et se grave sur le corps, c'est agir en tisserand des langues mouvantes. Après l'unique trait de pinceau, le souffle dans le geste à encre noire, la respiration du lecteur donne vie au texte comme à la ville. La destinerrance dans les espaces, rejoue les dérives psycho-géographiques dans la ville du cru du Drac.
L'anti Don Juan serait le détour de l'oralité pour elle-même, comme un rêve où l'inconscient structuré virgule comme un langage ne trouve sa solution que dans le lâché prise du sens.
- Construire un projet curatorial qui travaille la ville par la circulation de la parole, les ondes musicales.
- Inventer une autre écriture.
- S'extraire du bruit pour créer la khôra, une île, "(…) un troisième genre entre le sensible et l'intelligible, l'autre concept de l'espace!"(D.P., Ibid, p.48).
- Faire surgir cette cartographie musicale renouvelable chaque jour.
- Considérer les bruissements de la polis comme une organisation éphémère de l'individu de passage.
La géographie de la ville - constituée d'articulations multiples, d'ancrages et de délocalisations vécus et représentés par le sujet - matérialise, dans une temporalité élastique, l'aire matricielle des êtres qui la pratique, qui deviennent les producteurs d'eux-mêmes et non de quelque chose. Révéler cette khôra toujours mobile qui rend chacun des "viveurs" de cette ville des interventionnistes opérants.
- Concrétiser l'effilochement des phrases de ceux qui cherchent à créer du sens.
[Sortir de La stase des phrases en phase avec les aphasiques corporalités. introduire les sinuosités dans les terrains vagues de sens - unique priorité des villes pour civils en veille]
D. B. |